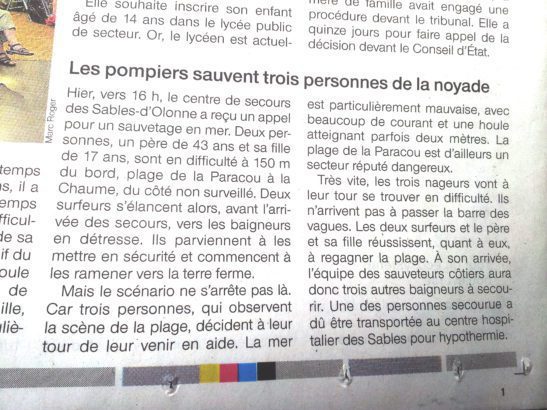L’été dernier, j’ai fait une rencontre… Alors une rencontre… Ça a changé ma vie. J’ai rencontré Mitch. On s’est rencontrés en faisant de la natation. D’abord j’ai nagé tout seul, et à un moment donné, Mitch est arrivé comme ça, l’air de rien et m’a demandé si je voulais pas nager avec lui. Et moi, je sais pas pourquoi, sur un coup de tête j’ai dit oui. Mitch n’était pas tout seul. Il était avec deux collègues, mais qui nous ont laissés rapidement. C’est que Mitch travaillait, ce jour là. Donc, grâce à la discrétion de ses collègues, Mitch et moi on s’est retrouvés tous seuls dans les vagues vendéennes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait trempette avec un pompier dans l’atlantique… C’est quelque chose. Et tous les deux on a tout de suite sentis qu’il avait quelque chose de fort entre nous. D’abord des vagues de trois mètres. Puis la ligne qui attachait Mitch à ses collègues à la plage. Et eux, d’ailleurs probablement jaloux de notre intimité houleuse, ils tiraient comme des fous pour nous ramener sur la plage. À un point qu’on n’arrivait plus à sortir la tête de l’eau. Et puis Mitch, il a fait ce qui m’a prouvé qu’il tenait, comme moi à vivre à fond ce moment dans l’eau froide, Mitch il a ouvert son harnais et a lâché la ligne.
Il m’a dit plus tard, dans l’ambulance, que c’était pour pas qu’on se noie, mais je sais lire entre les lignes, moi. Vraiment seuls maintenant, emportés à nouveau au large par le courant et les vagues, Mitch et moi, on s’est regardés, puis on s’est tenus la main, c’était évident qu’on voulait la même chose. Survivre, d’abord, bien sur, mais derrière tout ça il y avait autre chose. Les rochers. Et les méduses. J’ai du mal à rendre justice à ce moment avec les mots, il fallait être là, nous voir dans l’eau, Mitch et moi, main dans la main, épaule à épaule, ballotté par les vagues, immergés à intervalles irréguliers par la barre des vagues. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin, et Mitch, il était au travail quand même, il n’était pas là pour s’amuser. Et je crois aussi qu’il n’assumait pas complètement. Il n’a pas osé de mettre tout le paquet pour cette première rencontre. Ce qu’il était pudique, Mitch. Il m’a avoué après qu’il avait préparé plus pour moi, que l’hélico pour nous sortir de là était déjà en route. Il a du se dire que ça faisait peut-être trop pour une première rencontre et du coup on a continué à nager jusqu’à mettre pied sur terre ferme.
Mitch et moi on s’est retrouvés sur cette plage idyllique, complètement désert (si on fait abstraction des dizaines de pompiers, des policiers et de la centaine de badauds en maillot de bain qui filmaient avec leur téléphone portable). Et là, Mitch m’a abandonné. Je pense que le regard des autres était trop fort, ou peut-être était-ce la tristesse que ça n’allait pas aller plus loin entre nous, lui le pompier-plongeur qui sauve des vies et moi, l’artiste-branleur qui se noie.Les collègues de Mitch se sont mis à me toucher à leur tour, à me couvrir d’attention et d’une couverture chauffante, ils me chauffaient bien, quoi. Il y avait Gui-Gui, Jojo et les autres. Mitch est quand même venu me voir dans l’ambulance pour dire au revoir. On s’est mis d’accord qu’on n’allait plus se voir, du moins pas dans des circonstances aussi engageantes. Une fois mon Parkinson temporaire passé et ma température remonté dans des sphères mesurables par des thermomètres, je me suis rendu compte: Je l’avais échappé belle. Donc merci à Mitch et ses collègues sans lesquels ce texte serait un texte posthume. Je vous remercie de m’avoir lu et faites attention à vous! C’est pas tous les jours qu’il y a un Mitch qui vous sort de là.
(En hommage aux pompiers de Sables-d’Olonne. Le 4 août 2015, j’ai failli mourir noyé. Ils ont décidés que ce n’était pas une superbe idée.)

Souvenir de l’hôpital 
Sur la route du retour (de la mort) 
Urgences. Hypothermie. Attente 
Page 5 du journal local. Déçu. Ça aurait mérité une page 3.